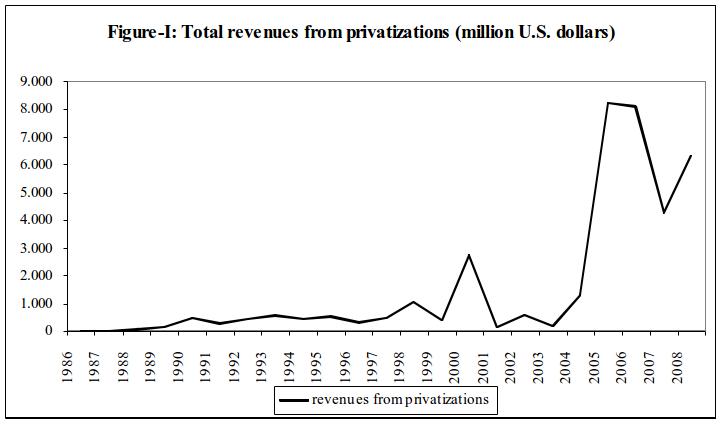Quels avantages et désavantages y a-t-il à examiner l’actuelle crise du système capitalisme selon une perspective historique à long terme ?
Le désavantage manifeste d’une telle perspective est que, si on englobe de longues périodes historiques, c’est-à-dire diverses périodes du capitalisme, bien des spécificités et dynamiques réelles de la lutte des classes sont nécessairement exclues ou réduites à leur plus simple expression. La recherche sur les hégémonies du système capitalistes établies à l’échelle mondiale masque plus ou moins les particularités des relations de différents pays avec les structures hégémoniques à divers moments de la hiérarchie donnée. Regarder dans le « long terme » rend la chose inévitable…
L’avantage d’une telle périodisation, d’autre part, c’est qu’elle permet de développer une compréhension de divers phénomènes dans le contexte des lois du mouvement du mode capitaliste de production au niveau de l’histoire du monde, plutôt que de traiter tous ces phénomènes un par an. Des abstractions théoriques sur les lois du mouvement du système tout entier permettent à l’analyste d’investiguer sur le comportement d’un seul pays ou région sur base de ces constructions théoriques. En d’autres termes, dans ce contexte analytique, le mouvement ou le comportement du système tout entier est pris comme un déterminant du mouvement ou du comportement de ses composantes.
En raison de sa profondeur et de son extension, l’actuelle crise a mis en évidence des questions sur le mouvement du mode capitaliste de production en tant que système historique mondial. On verra la chose comme une ironie de l’histoire, puisque l’ordre du marché avait affirmé sa « victoire définitive » dans le domaine idéologique après la disparition du socialisme véritable et que, après deux décennies à peine, la question qui se pose déjà est celle-ci : « Comment le capitalisme va-t-il poursuivre sa route ? »
Pour l’instant, le point de référence historique le plus fréquemment cité est le krach de 1929 et la Grande Dépression des années 1930. Nous savons que cette turbulence a conduit à une nouvelle guerre mondiale et que ce n’est qu’après que la hiérarchie capitaliste a pu changer. La référence à 1929 est bien fondée, sous cet angle; l’actuelle hiérarchie capitaliste pourrait également changer après des chocs aussi intenses. Les universitaires marxistes s’intéressent depuis longtemps à la question que voici : « De quoi le monde aura-t-il l’air après un tel changement ? »
Le plus grand défaut de la reconnaissance de la crise du système capitaliste et de la période que nous venons ainsi de traverser, c’est qu’elle implique qu’on ne fasse guère attention au « facteur subjectif » dans l’histoire, c’est-à-dire qu’on ramène les impacts de la lutte des classes sur le cours de l’histoire à l’une ou l’autre « distribution de probabilité ». Selon ce genre de perception, l’effondrement du système comme résultante d’interventions révolutionnaires n’est qu’un aspect, une probabilité offerte dans tout l’éventail de ce qui a été distribué ; par conséquent, de cet angle, qui nullifie le rôle de la subjectivité, il n’est pas possible de développer un cadre analytique susceptible de reconnaître le processus en termes d’opportunités, de conditions préalables, d’inconvénients, de tâches et de responsabilités face au sujet révolutionnaire de l’histoire.
Alors, comment allons-nous procéder ? Comment allons-nous construire notre méthode analytique ? Naturellement, nous percevons le monde par la lorgnette du marxisme-léninisme et nous ne risquons donc pas de nous épuiser dans une interminable recherche de méthodologie. Nous avons notre propre méthodologie, qui consiste à percevoir les changements historiques et, puisque nous sommes des matérialistes, certes, nous ne banaliserions pas le mouvement des facteurs objectifs et, en tant que personnes étudiant la logique dialectique, nous nous concentrerions sur les surfaces d’interaction entre les facteurs subjectifs et les facteurs objectifs et nous saisirions la force et la direction des vecteurs émergeant dans cet espace.
Alors, la question cruciale pour nous n’est pas ce que sera l’avenir du capitalisme et notre tâche ne consistera pas à spéculer sur la forme de la hiérarchie impérialiste au cours des décennies à venir. Nous considérons plutôt les possibilités d’une révolution socialiste qui pourrait émerger du tableau actuel. La rivalité, les tensions et les luttes pour le pouvoir entre les forces impérialistes n’ont de sens que dans ce contexte.
Permettez-moi de m’attarder encore un peu sur la crise de 1929 en tant que point de référence historique une fois de plus. La question fondamentale n’est pas de savoir comment l’impérialisme a réagi à la Grande Dépression et si, oui ou non, ces réponses pouvaient se répéter dans la situation actuelle. Examinons plutôt les conflits historiques accumulés par la Grande Dépression et le développement inégal de ces conflits et contradictions. Dans quels territoires et à partir de quelles dynamiques de classe la grande crise du système capitaliste offrit-elle des possibilités révolutionnaires ? Jusqu’à quel point la classe ouvrière et les masses laborieuses mondiales purent-elles tirer parti de ces possibilités et comment l’impérialisme se restructura-t-il après la catastrophe qu’il avait provoquée ?
Recourir à la perspective à long terme que j’évoquais au début serait utile, à ce propos. Toutefois, afin d’écarter ou, du moins, minimiser les inconvénients de cette perspective, nous pourrions bâtir la nôtre depuis les sphères dans lesquelles les contradictions du système s’étaient accumulées jusqu’au système dans son ensemble. Ce faisant, nous pouvons atténuer, sinon surmonter, la tension entre l’analyse concrète de la situation concrète de la lutte de classe et la périodisation historique du mouvement du système tout entier.